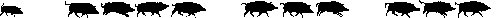Histoires de cochons, Manuel à l’usage des éleveurs modernes du porc Conte de fées Il était une fois et même quelquefois, au début, dans la nuit froide, alors que je contemplais le grand tas tranquille et chaud de pelages noirs, qui sentait bon les tapis berbères et le sol forestier, et d'où montaient régulièrement des grognements, des borborygmes, des jappements et aussi des pets retentissants, j'eus cette sensation curieuse, comme une envie soudaine de me coucher, nu, parmi eux et de faire ainsi partie de notre grande Mère paisible. Si je ne l'ai jamais fait, c'est à cause des sabots. En hiver, lorsque le temps est au gel, un tel amas est en mouvement de convection permanent, les bêtes couchées sur le bord essayant de se faufiler vers le centre et le sommet qui crache, comme un volcan, le corps de ceux qui sont bien au chaud à l'intérieur et, sans doute, près de suffoquer et donc peu enclins à opposer une résistance. Quand il fait moins froid, les groupes sont plus petits, les cochons sont allongés les uns contre les autres, les petits entre eux ou carrément couchés sur les grands. S'ils n'ont pas faim, ils prennent du bon temps. Ils font la grasse matinée et se lèvent quand le soleil est bien chaud. Ils partent ensuite par petits groupes, formés du noyau familial, accompagné de quelques amis, faire un tour dans la forêt, et, s'il fait sec et chaud, reviennent au bout de quelque temps vers le point d'eau pour une autre sieste, à moins qu'ils ne disparaissent pour la journée dans les bois jusqu'à l'heure du dîner, quand je sonne le bugle et que tout le monde accourt pour un repas de pain (que je récupère dans les supermarchés), ou, une fois par semaine, de poisson (que m'aura gardé mon ami, le poissonnier du marché), ou encore d'orge ou de blé germé, que j'achète chez un paysan, lequel est trop pauvre pour se permettre d'épandre beaucoup d'engrais ou d'herbicides dans ses champs. Lorsqu'il y a abondance de châtaignes et de glands, cette alimentation est plutôt symbolique et ne sert qu’à maintenir le contact. Mais leur santé et leur bonheur, les cochons le puisent toute l'année dans l'herbe, les feuilles, les racines de fougères et de ronces, les insectes, la terre, et à l'occasion, un renard ou un chien, qui se serait aventuré trop près. Les origines Depuis une quinzaine d'années, je vis dans le midi de la France avec un petit troupeau de cochons, moi dans la maison, les cochons dans la forêt autour. Lorsque j'ai acheté cette vieille ferme abandonnée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Des moines et des paysans avaient vécu ici durant plus de mille ans. Au début du siècle la plupart de ces derniers avaient été attirés dans les mines et après l'hécatombe de la première guerre mondiale, il ne resta que les vieillards, les veuves et les enfants pour pleurer le lent déclin du pays. Les mines ont fermé. La plupart des neo-ruraux de cette région élèvent des chèvres. Une occupation méritoire, certes, mais ingrate, car il faut traire ces bêtes deux fois par jour pour la production de fromage et les mener paître dans la forêt. L’effet funeste des chèvres sur celle-ci est bien connu. D’autant plus que cette pauvre forêt a déjà souffert d’un siècle d’exploitation minière, de l’abandon des fermes et des nombreux incendies qui continuent de la dévaster. De toute façon, après quelques années, pour des raisons d'efficacité, ou bien par paresse, ces nouveaux paysans finissent par les enfermer dans un grand hangar et là, continuent de fabriquer leur fromage fermier (labelisé). Rares sont ceux qui continuent de mener le troupeau à la montagne. D'autres se mettent à cultiver quelques terrasses pour produire des oignons, des pommes de terre ou de petits fruits rouges. C'est en Espagne, où je passais des vacances, que j'ai vu pour la première fois ces jolis petits cochons noirs sous les chênes verts et les chênes-lièges. Je me suis dit que ces animaux devaient aimer fouiller dans les broussailles qui couvrent les collines qui nous entourent, et où se plaît le sanglier. Tout le monde sait maintenant que ce sont des animaux propres, intelligents -les plus intelligents après les singes et les dauphins-, qu'ils sont proches de l'homme par bien des aspects, et peut-être à cause de cela, souvent décriés dans l'histoire de l'être humain en tant que proche parent d’un Dieu jaloux. Ce ne sont pas non plus des Napoléons ou des Babes. Ni, surtout, les pauvres monstruosités que l'ignorance et la cupidité humaine en ont faites. Je dis aussi: pour être saine, la viande doit être heureuse. Un jour nous aurons la possibilité de le constater.(1) Notre futur sauveur (les cochons dans la forêt) Après la diabolisation, la rédemption ? Le cochon comme sauveur de la forêt, le seul quadripède domestique à la suite duquel celle-ci ne disparaît pas à terme ? Sachant combien il est important de sauver et de restaurer cette partie essentielle de notre biosphère, il serait irresponsable, par les temps qui courent, de ne pas y faire contribuer le cochon. Le cochon laboure, aère et fume la terre sous les arbres; les racines des fougères et des ronces font partie de sa nourriture. Il ne détruit pas une forêt comme le font les soi-disant herbivores.(2) Sous l’action d’un troupeau de cochons la forêt devient enfin, sans utilisation de grands moyens, ignifuge. Elle devient par là exploitable, tout en nourrissant les hommes et les bêtes. (Il s’agit ici de forêts de feuillus, les pins ne formant pas de couverture forestière naturelle dans nos contrées : ils sont destinés aux étendues pauvres et froides). Aux cochons, j’ai ajouté un petit troupeau de moutons, qui mangent ce que le cochon délaisse, genêts et bruyères, ainsi qu’une importante basse-cour s’égaillant à leurs traces sous les arbres, durant la journée. Vie des cochons Mes cochons s'arrondissent à l'époque des châtaignes et des glands. Leur couche de graisse commence à fondre vers la fin du printemps, quand, dans la forêt, ils ne trouvent plus grand-chose et que je dois les nourrir à partir de mes modestes ressources. Leur croissance continue jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans, leur poids s'établissant autour de 130 kilos pour les truies, entre 160 et 180 kilos pour les mâles. Au bout d'un an ils ne pèsent donc qu'environ cinquante kilos, alors que dans l'élevage industriel un cochon doit peser cent kilos à cinq mois. Je vends des porcelets sevrés à des fermiers qui n'hésitent pas à les pousser à plus de 200 kilos en moins d'un an, ce qui semble les combler, ces fermiers. Un enfant humain, qui a une même prédisposition à l'engraissement, devrait peser aux environs de cent kilos à l'âge de sept ans s'il voulait combler pareillement ses parents. En réalité ces animaux sont suralimentés, leur métabolisme marche à pleine vapeur, leurs organes digestifs sont hypertrophiés. Dans le mémento de l'éleveur j'avais lu qu'un cochon à l'engraissement doit boire entre 10 et 15 litres d'eau par jour. Ce qui ne laissait pas de m'inquiéter, car la citerne dont je disposais ne contenait que 5000 litres. J'ai donc dû mesurer leurs besoins quotidiens. À mon grand étonnement, en plein été, lorsqu' il n'y a plus de flaques d'eau où ils peuvent se désaltérer, la consommation moyenne n'a été que d'un demi-litre d'eau par jour, bien qu'ils eussent un abreuvoir automatique à leur disposition. Peut-être que l'eau n'avait pas bon goût, mais peut-être aussi qu'un cochon, menant une vie normale, a des besoins en eau bien plus modestes. Les truies les plus âgées à la ferme ont aujourd'hui 14 ans - l'autre jour nous avons enterré Beatrice, qui en avait seize. Elles sont en pleine forme, et ont une portée tous les ans, parfois plus, généralement au mois d'avril. Elles construisent un grand nid de branches, de bruyère ou de genêts. Par grand froid ou par temps de neige, elles s'installent sous cette couverture. En se promenant dans la forêt, on aperçoit de loin un monticule blanc d'où s'élève quelque fumerolle, ainsi qu' un grognement menaçant si on vient trop près. Une portée compte sept à neuf petits cochons. Je ne sais combien il peut en mourir les premiers jours, la nature se chargeant de faire disparaître les petits corps. Ils sont probablement la proie des corbeaux ou des buses. Il m'est arrivé de voir la mère se charger du devoir pénible de les manger afin de faire disparaître toute trace de viande pourrie des alentours du nid. Une amie, dont la présence est tolérée près du nid, dévore quelquefois les mort-nés avec nettement plus d’appétit. Un renard parfois guette le nid pendant les deux premiers jours et, lors d'une courte absence de la truie, parvient à s’emparer d’un petit. C'est pourquoi, dès qu'ils voient un renard, les cochons lui font la chasse. De même pour un chien ou un blaireau, quelquefois avec succès. Si une truie a été trop bien nourrie- elle doit être enfermée pour cela-, elle fait jusqu'à treize porcelets, auquel cas j'en perds souvent deux ou trois dès le début. Trop lourde et peu agile, elle en écrase, surtout parce que le groupe de petits, au delà de neuf, se scinde toujours en deux, et que, par conséquent, ils ne se trouvent pas toujours du même côté de leur mère lorsque celle-ci se couche pour les allaiter. Pour la mise-bas, les mères choisissent un endroit élevé et sec, mais il est arrivé qu'une truie, pas la plus intelligente, perdit sa portée, après qu'une grosse averse eut transformé le trou qu'elle avait creusé, en piscine. Triste spectacle, que nous n'oublierons pas de sitôt. Comment tuer les cochons en observant leur queues La première fois que j’assistai à une mise à mort fut lors du rituel annuel chez un voisin. Le cochon, une bête rose, qui devait bien faire dans les deux cents kilos, dut être tiré de sa cave- l'endroit par excellence recommandé par la tradition pour engraisser un cochon fermier- par quatre hommes costauds, à l'aide de cordes, avec force cris et un effort musculaire considérable, vers une sorte de grand cercueil retourné où nous le couchâmes sur le côté, le groin et les pieds fermement liés, avec le savoir-faire d'une pratique ancienne et quasiment sacrée. (Ce rituel, et d'autres, ne sont que le faible écho d'un lointain passé mythique, quand le cochon symbolisait l'homme brut, qu'il fallait sacrifier, ou au contraire invoquer, selon sa nature diabolique ou divine).(3) Ce branle-bas dura environ un quart d'heure, le pauvre animal n'ayant évidemment aucune envie de faire connaissance ainsi avec la lumière éclatante du jour. Aucune cruauté manifeste à son égard, si ce n'est les remarques désobligeantes et les jurons qui servent à neutraliser l'effroi qui nous saisit chaque fois que nous devons faire souffrir un être vivant. Et aussi, il est plus facile de tuer ce qu’on déteste. Ceci dit, une fois solidement attaché, le cochon fut saigné sans bavure, et tout le monde était content. La fête du charcutage pouvait commencer. La semaine dernière j'ai tué Karine, une petite truie affectueuse, mais aussi très nerveuse que je ne voulais pas garder. Voici comment j'ai procédé. Je me suis levé et après avoir bu mon bol de café au lait de chèvre et mangé un oeuf de poule demi-sauvage à la coque, j'ai pris mon 22, un couteau solide et un petit seau. Les cochons que je veux tuer ou vendre passent les mois de l'hiver dans un parc près de la maison. Tous les matins je leur donne un demi-seau de grain, afin de les avoir sous la main. Je répands une mince rangée d'orge par terre, qu'ils se mettent à manger allègrement. Je me suis donc promené avec ma carabine, ai repéré Karine et je l’ai gentiment poussée vers l'endroit qui me convenait. J’ai placé le canon contre sa tête, un peu au-dessus de la ligne entre ses deux yeux. Comme elle était en train de manger, j’ai dû plier mes genoux pour être bien en face d'elle. Je lui ai dit: Ma petite Karine, tu vas maintenant aller vers les champs élysées pour les cochons, et paf, la voilà par terre. J’ai plongé mon couteau dans sa carotide et j’ai laissé le sang jaillir dans le seau, et je fus content parce que cela s'était encore passé sans anicroche. Comme il n'y avait pas eu de signal d'alerte, les autres continuèrent de mâcher tranquillement leur grain. J'appelai ma femme pour qu'elle m'aide à tirer Karine, ou ce qui en restait, sur la brouette et nous la roulâmes vers le devant de la maison, où je passai deux heures dans le soleil matinal à la dépecer, la vider, la couper en deux et à nettoyer les boyaux sous le robinet d'eau tiède. Ces boyaux sentent bon, rien à voir avec l'odeur fétide de ceux que nous prenons parfois à l'abattoir, qui sont couverts d'une muqueuse gluante et qui continuent à sentir mauvais jusqu'à ce qu'ils se soient transformés en saucissons secs. Mais comme il faut une estampille pour pouvoir les vendre, la plupart de nos cochons sont tués à l'abattoir. Un dur passage pour eux. Je dois les faire monter dans notre fourgon, l'occasion pour moi de découvrir qu'une truie en bonne forme peut sauter une barrière de 1.10m sans effort, la touchant à peine, dans un mouvement d'une force et d'une élégance inouies ( celle-là, bien entendu, je devais la tuer plus tard). Normalement, avec un peu de persuasion, j'arrive à les faire entrer dans le fourgon en question, qui, soit dit en passant, a acquis au cours des années une odeur « sui generis » indélébile, dûe aux nombreuses matières et animaux transportés. C'est un trajet d'une trentaine de kilomètres, depuis que l'abattoir local a été fermé pour cause de normalisation européenne. Dans le fourgon les cochons sont inquiets, en colère ou abattus. Quelques uns se couchent, feignant une léthargie, les autres restent debout, essayant de garder l'équilibre. A l'abattoir je les mène dans une "loge" en béton, où ils doivent rester jusqu'au lendemain matin. En général j'évite d'amener une seule bête. Ainsi, au moins, elles ont la consolation d'être plusieurs. Je dois dire que nos cochons sont clairement moins stressés que les autres qu'on voit là-bas, les yeux exorbités de frayeur. Nous amenons des bêtes qui ont connu la liberté et qui sont simplement étonnées ou abattues de ne plus l'avoir. C'est grâce à la liberté qu'ils ont gardé la queue souple et droite, comme celle d’une vache, avec laquelle ils peuvent manifester leurs émotions. Dans leur loge cette queue est entre leurs pattes ou bien recroquevillée, signe d'excitation, mais le plus souvent droite, ce qui veut dire qu’ils ne s’inquiètent pas trop. Tous les autres cochons ont la queue, ou ce qui en reste, en tire-bouchon, le signe bien-connu de leur « joyeuse » disposition. C'est lorsqu'ils sont excités, c'est à dire quand ils mangent à plusieurs ou se battent, qu'ils la tordent, surtout dans leur jeune âge. Cette torsion se fige lorsque les animaux sont par trop souvent stressés, notamment quand ils manquent d'espace. Dans un petit parc qui couvre environ un hectare, je garde, pendant une grande partie de l'année, le verrat avec deux truies pour la compagnie. Or, la moitié des porcelets qui y naissent et que je remets après six mois dans la forêt avec le troupeau, aura définitivement la queue en tire-bouchon. On peut en déduire qu'il y a un espace vital pour les cochons d'un hectare minimum.. Aléas Souvenir…C’était une belle matinée, dimanche, le printemps. Assis sur le bout d’une chaise sur la terrace avec vue sur les collines ensoleillées, j’eus cette pensée: si je laisse aller, je serai mort dans quelques minutes. Une belle mort, en somme. Avec mes deux poings je serrais une serviette ensanglantée contre l‘arrière de mes cuisses. J’attendais l’hélicoptère qui allait me porter de l’assistance médicale. Tout était silencieux et serein. Des poules picoraient dans le pré. Au loin le pépiement des oiseaux, quelques grognements de cochons dans la forêt. Je ne souffrais pas; j’étais tendu et paisible en même temps. Je vis descendre l’hélicoptère, des gens qui en sortaient et qui venaient vers moi. Ils me parlaient, je ne me rappelle plus ce qu’ils faisaient ou disaient. Ils m’enveloppèrent dans un brancard gonflable. J’entendis le médecin dire: Mmm, un petit six. J’ai dû leur demander d’appeler F. pour lui dire de venir et de nourrir les animaux, puisque je ne serais pas là, le soir. En route vers l’hôpital j’étais conscient des repères dans le paysage en-dessous de moi. Couché sur mon ventre, cet après-midi là, j’eus des bribes de conversation avec le chirurgien syrien qui dirigeait l’équipe médicale derrière l’écran vert, qui séparait mon bas de mon haut. Je me disais qu’il ne devait pas être content d’avoir affaire à un patient qui avait été malmené par un cochon, mais je ne le lui demandai pas, pensant qu’après tout de nombreux Syriens en France devaient être chrétiens. Quoiqu’il en soit, et cela plaidait en faveur de ma première impression, il m’avertit des dangers d’une telle blessure, me parla des moeurs innommables de la gente porcine et que je pouvais m'attendre à voir se développer une septicémie, sinon du tétanos. Plus tard nous liames amitié et il se proposa de venir me rendre visite chez moi, ce qu’il ne fit jamais. Désormais j’avais deux longues cicatrices à l’arrière de mes cuisses, dont je pouvais faire montre chaque fois que je me baignais en public, ce qui, ajouté aux nombreuses autres marques sur mes jambes, résultant d’accidents dans mon enfance et d’autres rencontres avec les défenses acérées de mes nouveaux amis, ne laissait pas de faire grande impression. Le pourquoi Je n’avais pas l’élevage du cochon dans le sang et je devais par conséquent recommencer à zéro, avec le parti-pris et les sentiments d'un homme de la ville. J'avais quarante ans quand je tuai ma première poule, la hache dans une main tremblante, conscient que j'allais transgresser le code moral qui m'avait été inculqué dès l'enfance, conscient aussi que je devais le faire parce que je mangeais de la viande et devais l'assumer. Je voulus être fermier, ou plûtot, paysan, prendre part à un mode de vie plus proche de notre réalité animale, éloigné d’un monde devenu trop confortable et virtuel. Tous ces grands penseurs et écrivains qui chantent les louanges de la vie bucolique, à commencer par mes auteurs classiques bien-aimés, ne pouvaient avoir tort. Ils n’ont pas tort, car ce rêve est universel. La citation en épigraphe est au-dessus de mon bureau (ou peut-être ailleurs). Il en ressort que, déjà à cette époque, un homme éminemment averti pouvait considérer qu’un paysan était plus libre et plus indépendant qu'un roi et que l’harmonie avec la nature forme la base de cette liberté et de ce bonheur. Les contraintes que la nature impose font qu’on est moins enclin à prendre des vessies pour des lanternes. Ce n’est pas pour rien que, de tous temps, les mauvais gouvernements ont eu fort à faire avec les paysans. J'ai vu de vieux paysans pleurer de n'être plus que des exploitants agricoles, parce que, l'ayant connu, ils avaient perdu ce contact direct avec la terre. Aujourd'hui, dans nos contrées, rien ne nous empêche d'être ce paysan-là et en même temps poète, comptable ou astrophysicien. (4) Oreilles et autres narines Parmi mes premières bêtes, il y en avait avec des oreilles immenses. Je me suis rendu compte que ces "oeillères" avaient été introduites par sélection, afin d’obtenir un animal qui ne se montrerait pas trop entreprenant lors de ses promenades dans les villages médiévaux où il faisait office de ramasseur d’ordures (organiques) ou pendant les glandées sous surveillance du porcher. Au début du siècle dernier on ouvrait, à la tombée de la nuit, les portes des cités indiennes, souvent habitées par une population musulmane, afin de laisser rentrer un troupeau de cochons pour y faire sa besogne de nettoyage. Dans la forêt, cependant, ces oeillères forment un sérieux handicap, tronquant la vue et l’ouïe, de sorte que ces pauvres animaux arrivent toujours en dernier lorsque je sonne la trompette. En courant ils butent contre les arbres. Souvent même ils ne s’aperçoivent pas qu’il est temps de venir manger, occupés comme ils le sont à creuser dans la terre, sans remarquer le remue-ménage chez les autres. Ils en deviennent maigres et grognons. J’essaie de sélectionner des oreilles droites pour mes reproducteurs, avec l’aide occasionnelle et bienvenue d’un petit sanglier mâle de passage. Mais le sens principal du cochon réside dans ses narines espacées, grâce auxquelles il est capable de détecter et de situer exactement un grain d’orge à dix ou quinze centimètres, même sous une pierre et dans la nuit. Accidents Hormis les rhumes occasionnels, je n'ai jamais eu de cochon malade. Ils n'ont jamais eu de médicaments, ni d'ailleurs d'hormones de croissance, d'aliments liquides ou autres tourteaux de soja, grâce auxquels nous appauvrissons le sol et les populations du tiers monde. Une fois par an je leur distribue un vermifuge. Mais des accidents surviennent. Quand ils avalent un clou, par exemple, ou un morceau de bois trop grand et trop dur. Ils s'arrêtent alors de manger et meurent d'hémorragie interne au bout d'une semaine. Dans ces cas-là je n'interviens pas. Il y a un an, un de mes grand cochons castrés manifesta des signes de malaise, il s'arrêta de manger et, après quelques jours, de boire. Une semaine plus tard, voyant qu’il s’affaiblissait, je l'amenai dans l'étable des chèvres, près de la maison, et le couchai dans la paille confortable. Je l'observai ainsi pendant un certain temps, couché sur le côté sans bouger, maigrissant de plus en plus; une ou deux fois par jour je basculais sa grande carcasse sur l'autre coté, jusqu'au jour où, environ un mois plus tard, il se mit à lamper, avec de petites gorgées émouvantes, le lait de chèvre tiède que je lui tendais. Après cela il reprit graduellement goût à la vie. Ce qui me rappelle la performance étonnante d'une jeune truie, à l'époque du début, lorsque le troupeau paissait encore librement dans les collines sur les terrains de la commune, sans être enfermé dans des parcs clôturés. Elle n'était pas rentrée le soir avec les autres, et comme elle ne revint plus le lendemain, ni les jours suivants, je la crus morte, accidentée ou la proie de quelque braconnier, jusqu'au soir, où, deux mois plus tard, tandis que je donnais à manger au troupeau au sommet de la colline, je vis au loin sur la piste une espèce de fantôme squelettique qui s’approchait avec une incroyable lenteur. Quand elle fut plus près, je la reconnus à ses yeux et l'expression de son visage. De chaque côté du cou, elle avait une marque profonde, dépourvue de poils, comme si elle avait été prise dans une fourche, peut-être un jeune arbre fendu, ou bien un grand piège, du genre qu'on trouve plutôt en Afrique. Je suppose maintenant, qu'elle avait dû rétrécir avant de pouvoir se libérer, et que pendant tout ce temps, elle n’avait ni mangé, ni surtout, bu, sauf peut-être quelques gouttes tombées du ciel. Il est vrai que les cochons n'ont pas de glandes sudoripares et que leurs besoins en eau sont par conséquent modestes et qu'en outre elle a pu être restée emprisonnée sur un versant où le soleil ne pénètre que rarement. Cette truie est aujourd’hui un des plus beaux specimens du troupeau, et, même avant la mort de Béatrice, une cheftaine. Il n'est donc pas exceptionnel qu'un cochon se soumette à un jeûne de plus d'un mois. Il est arrivé qu’on tenta d’empoisonner mon troupeau : sept cochons moururent, j’en conduisis d'autres, affaiblis, dans le pré devant la maison, où, pendant des heures, ils broutèrent sans distinction des herbes de toutes sortes, comme mus par un fol instinct. Ces cochons-là finirent par se rétablir. Poux Il y a quelques années, on m'amena une truie noire, dans le but de la faire saillir par mon verrat. Elle resta une semaine avec lui dans un petit parc de contention, puis le verrat repartit dans le troupeau. En l'espace de quelques semaines le troupeau entier fut couvert de poux, de ces grands poux spécifiques aux cochons, qui sont restés depuis, dans une moindre mesure dans le troupeau, où les cochons s'en débarrassent pour la plupart en se frottant contre les arbres, en se roulant dans la boue, ou en courant vite. Mais dans les parcs de taille réduite, l'infestation peut atteindre des proportions inquiétantes. Un bain d’huile est alors indiqué. Dans un livre sur la vie à la campagne, j'avais trouvé une recette selon laquelle il fallait verser de l'huile de vidange sur les bêtes. Ce que j’ai fait, une fois, sur Figue, ma plus vieille truie, après quoi j'ai cru bon d'abandonner l’idée. Depuis, je laisse un grand bidon dans l’une des deux maisons de retraite de la petite ville voisine, dans lequel le cuisinier vide son huile de friture usagée, principalement de l'huile de tournesol (l'autre maison de retraite a subi une modernisation importante et du même coup un reserrement des règles d'hygiène, qui interdisent la vidange de l'huile utilisée ailleurs que dans l'évier). Je me sers de cette huile depuis vingt ans pour la lubrification de mes chaînes de tronçonneuse et pour la conservation du bois et du cuir. Et je l’utilise contre les poux. J'en verse une généreuse rasade sur le dos du cochon, de la tête à la queue, et hop...plus de poux. Dix jours après je répète l'opération, afin de surprendre les lentes écloses. Comme elle est gratuite et biodégradable, je peux en utiliser autant que je veux. On pourrait sans doute l'utiliser contre n'importe quel insecte, puisqu'elle en obstrue les trachées. Jusqu’ici, malheureusement, je n'ai pas pris le temps de traiter le troupeau entier. Cette huile n’est nuisible ni aux cochons, ni à l'environnement. Ils adorent se lécher après. La poule au pot J’écris ces lignes par une belle journée de juin. Grâce aux orages de ces derniers temps, l'été commence en un jaillissement de fleurs et de verdure. Hier, nous avons reçu un couple d'anglais pour dîner. Lui est écrivain, remarquable auteur de quelque six romans fascinants, jamais publiés. A cette occasion nous avons tué Hit. Je ne sais pas pourquoi les coqs boîteux sont toujours affublés de ces noms-là, peut-être parce qu’avec leur handicap grotesque ils font penser à de ridicules petits dictateurs, la poitrine en avant. Nous avons eu aussi quelques Nap. Quoi qu’il en soit, celui-ci méritait vraiment un traitement spécial, après son héroique combat de l'hiver dernier. Je fus réveillé en pleine nuit par les cris affreux et persistants d'un coq. Je passai ma tête par la fenêtre et aperçus à quelque distance une ombre s'agitant sur le sol enneigé. Rapidement j'enfilai ma robe de chambre, mis des chaussures et courus dehors avec ma toute nouvelle torche à halogène. Une fois arrivé dans le pré, je vis notre coq, qui décrivait des cercles dans la neige, traînant derrière lui deux fouines, qui lâchèrent prise et disparurent dans les buissons. La pauvre bête s’effondra, hébétée, la queue ensanglantée et déplumée. Il survécut cependant. Mais ces féroces petits prédateurs avaient également cassé sa patte. Ce brave animal méritait donc d'être choyé et de devenir l'objet d'une des prouesses culinaires de ma femme ainsi que d'une conversation entre convives. Nous avons aussi parlé de la petite Marianne, laquelle s’étant fait féconder par un sanglier, venait d'être délivrée de trois petits porcelets, tous morts, au cours d’une mise-bas qui avait duré trois jours, et nous espérions évidemment qu'elle survivrait. Elle est petite, a moins d'un an, et la queue en tire-bouchon, étant donné qu'elle nous vient d'une autre ferme pour renouveler le sang de mes reproducteurs. Mais cette naissance désastreuse peut aussi être dûe à un croisement avec une variété génétiquement différente, puisqu'il y a désormais des sangliers avec 38 chromosomes, qui sont importés du nord par les chasseurs, alors que notre cochon sauvage et le porc ibérique qui en descend, n’en a que 36. Les voies de la nature sont sondables, après tout. (1) Car la situation actuelle des cochons, des moutons, du bétail à viande, des poules est insupportable et incompréhensible. Elle est sans doute typique de la façon dont nous traitons la nature. Cependant, la maintenir ainsi est de plus en plus ressenti comme un affront fait à cette nature, et dans un sens plus étroit, comme un risque pour la santé publique et un manque de respect envers nous-mêmes. Nous sommes tous habités par le désir de beauté et d’honorabilité. Curieusement, nous courons comme des moutons après des idées et des choses qui n’ont souvent qu’un rapport pathologique avec ces valeurs. La terre est notre mère, pas notre ennemie. De toute façon, dans le siècle à venir, la biotechnologie nous offrira les moyens de fabriquer des protéines animales de toutes les variétés et saveurs qu’on voudra et si nous envisageons la forme d’un steak (ou d’un saucisson) comme une alternative acceptable pour les divers mets et morceaux choisis que peut nous fournir le corps d’un animal mort, au moins on ne tuera plus à des fins culinaires. Hélas, les raisons pour cela auront été d’ordre pratique plutôt que moral. N’est-il pas dit: erst das Fressen, dann die Moral ? Cette histoire sera alors, si elle ne l’est déjà, une description folklorique d’un autre âge (2) La Chèvre est une véritable catastrophe. Elle tue des arbres de cinquante ans, si elle en aime l’écorce et fait disparaître une forêt nourricière en un rien de temps. Le mouton est moins destructeur, mais arrive quand-même a se faire de jeunes arbres, s’il en aime le feuillage. Je ne sais pas assez concernant les vaches, mais je pense que, vu leur taille, ils peuvent faire pas mal de dégâts. Sur le chameau ou l’âne je n’ai pas d’information. Cependant, l’idée s’est fait progressivement jour chez moi que la disparition du cochon du Moyen-Orient, d’abord causée par la nomadisation croissante des agriculteurs à la suite d’une deforestation effrénée et de surpâturage, mais ensuite par son interdiction, pour des raisons diverses, par les castes régnantes, a pu être un facteur majeur conduisant à la désertification dans cette partie du monde et que, inversement, le retour à la forêt devra sans doute être accompagné par le rétablissement de l'élevage extensif du porc. Un beau sujet de thèse. (3) Voir, par exemple, le livre de Claudine Fabre-Vassas, La Bête Singulière, Éditions Gallimard, 1994. Egalement les pages consacrées au cochon dans la mythologie dans les volumes des « Masques de Dieu », en anglais, »The Masks of God », Penguin, 1976, par Joseph Campbell. .(4)Notre propre revenu annuel vient, pour moitié, de la vente d'une centaine de porcelets, ainsi que d'une dizaine de cochons charcutiers, l'autre moitié est assuré par la location de notre gîte. Une fois les ruines restaurées et les clôtures terminées, je passerai en moyenne deux heures par jour à m'occuper des animaux, outre les tâches d'entretien ainsi que la récolte des fruits et du foin. Les parcs couvrent environ quarante hectares et peuvent, pour l'instant, nourrir un maximum d'une quinzaine de truies suitées pendant six mois de l'année. La production de cette forêt, dans son état actuel, est limitée. Dans l’avenir une alimentation complémentaire sera quasiment superflue. © Augustin Thyssen 1999-2001 |