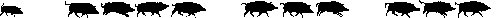| Les cochons dans la forêt des nez, qui touchaient la terre." ( Sinbad le Marin ) Depuis une vingtaine d’années je vis dans les Cévennes, entouré d’un petit troupeau de cochons merveilleux, délicieux et en bonne santé. Pour leur rusticité et leur esthétique, j’ai pris des cochons noirs. Ma devise est devenue: Une viande saine est une viande heureuse. Mais à côté de ça, le cochon est aussi le seul animal de ferme qui vit en bonne symbiose avec la forêt, je dirais même plus: sans le cochon (mais avec certains hommes), aujourd’hui, dans de nombreuses régions, la forêt sera vouée à une disparition plus ou moins totale. Par un curieux, et peut-être funeste, concours de l’histoire, l’homme s’est détourné de la forêt et s’est cru obligé de cultiver des plaines et de manger du pain. Le cochon rentabilise la forêt, puisqu’il s’en nourrit sans la détruire, il l’empêche de partir en flammes et, à terme, la rend exploitable à toutes autres fins utiles. Sur une cinquantaine d’hectares, aménagés en parcs, peut vivre une famille de paysans. Elle ajoutera aux cochons un petit troupeau de moutons, qui mangeront ce que les cochons délaissent, ainsi qu’une importante basse-cour, qui s’égaillera dans la forêt; elle pourra, enfin, planter des arbres fruitiers et cultiver des légumes sur quelques parcelles. Désormais elle fournira au village une partie de son alimentation, exempte de ce qu’on appelle des intrants, évitant des transports polluants et coûteux, garantissant la durabilité, universellement appelée des voeux. I Les avantages d’avoir des cochons dans la forêt, éventuellement en compagnie de quelques moutons, sont évidents. Ce sont les seuls animaux à vraiment vivre en bonne symbiose avec cette forêt, même en situation de surpopulation temporaire, du moment que les plus jeunes arbres ont plus de deux ans, parce que, plus petits, ils risquent d'être déracinés par ces diables de fouineurs. En effet, le cochon laboure où il peut, il aère le sol, le fume, il déterre et mange les racines des fougères mâles, des ronces, bref, il prépare un milieu ignifuge, sur lequel la forêt originelle, ici principalement des châtaigniers, des chênes verts, des variétés d'érable, cerisier et pommier, pourra se développer. Dans notre cas, la seule intervention humaine consistera dans l’élimination plus ou moins radicale des pins, qui présentent l’heureuse particularité de ne pas repousser à partir des racines. Le semis en sera soit déraciné par les cochons, soit mangé par les moutons, soit incapable de se développer sous la canopée naissante. Le paysage ici est constitué de versants montagneux que les anciens ont aménagés en terrasses, mais dont les murs se sont graduellement écroulés par manque d'entretien et par le passage de petits troupeaux de moutons et de chèvres. Les effets destructeurs d'averses violentes sur le sol de ces pentes sont bien connus; après plusieurs incendies il ne reste souvent que la roche nue, avec seulement quelques maigres pins accrochés aux fissures. Une multitude de sabots piétine la végétation et durcit la couche supérieure du sol; un troupeau qui dévale la pente fait tomber les pierres des murs, l'érosion peut faire son oeuvre, l'eau ruisselante créant des rigoles dans lesquelles elle coule de plus en plus vite, emportant la terre avec elle. C’est le commencement de la désertification. Certes, les cochons remuent les pierres. Mais pas exactement de la même façon. Car ils n'aiment pas sauter et feront le tour d'un muret jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une ouverture, souvent un mur déjà écroulé, et ils continueront d'utiliser ce passage. Outre qu'ils dénudent le sol, ils le labourent également, et ceci de manière à me rappeler les paysans suisses qui, avec leurs chevaux ou leurs braves petits tracteurs, font des sillons perpendiculairement à la pente afin d'éviter l'écoulement trop rapide de l'eau. Les cochons font mieux que des sillons: ils creusent de grands trous, si la terre est suffisamment meuble, augmentant par là de façon importante la capacité de rétention d'eau du sol. La fois d’après, ils creusent le trou juste à côté du précédent, remplissant celui-ci de terre fraîche, et ainsi de suite. Il est vrai qu’après leur passage le sol de la forêt présente un aspect de « champ de bataille » et il y aura inévitablement des problèmes d'érosion, mais ceux-ci peuvent être gérés localement en fabriquant des traverses ou des barrières avec des troncs d'arbres ou en construisant de nouveaux murs avec les pierres que les bêtes auront, au bout de quelques années, fait descendre à cet effet jusqu'en bas de la pente. Cela fait partie des tâches du paysan. Dès qu'un parc peut être libéré, par exemple, comme nous le faisons, à l’intérieur d’un système de rotation, on peut l'ensemencer durant une saison humide avec du seigle, de la luzerne ou de la vesce. J’ai pris l’habitude, lorsque je les nourris, d’épandre du grain sur le dos velu des bêtes qui le transportent au gré de leurs balades dans le parc. Chez moi, il reste suffisamment de graines d'herbes de toute sorte pour couvrir de verdure le sol de ces parcs en l'espace de quelques mois, même sous de grands arbres. Les cochons ont, rappelez-vous, préparé une excellente couche pour le semis. Mais leur fonction principale reste de sauver la forêt naissante des incendies. C'est un moyen bien moins coûteux et polluant que de faire faire le travail par les buldozers- les gens d'ici appellent cela "coller des timbres"-, lesquels dévastent un pan de montagne pour y faire une plantation, qu'ensuite il faudra entretenir pendant de nombreuses années, en priant les dieux pour qu’entretemps elle ne parte pas en fumée. D’autres moyens de lutte contre les incendies sont mis en oeuvre – l’été ici voit le cirque permanent des canadairs – mais le coût en est élevé et l’on peut se demander si le résultat en est durable sinon rentable. II Dans notre commune la forêt couvre une grande surface. Les plus vieux arbres n’ont que quarante ou cinquante ans, excepté dans quelque rare endroit abrité. Comme je l’ai dit, une grande partie en part régulièrement en flammes. Ceci est dû, notamment, au manque d'entretien et en raison de la prolifération du pin maritime, qui fut introduit au siècle dernier, et dont le bois servait à étayer les galeries de mines qu’on commença alors à creuser, en accord avec la croyance universelle qu’il émet des craquements avant de rompre. Pour l’heure, seuls les chasseurs occupent ce terrain. La chasse est peut-être une activité tout à fait honorable, l’effet sur la forêt en est pour le moins limité. L'état s'en enrichit de façon discutable, par la vente d'armes et de permis; une économie parallèle, basée sur la vente illicite de gibier, s'en trouve confortée provisoirement, mais il est clair que la chasse, même en France, va être de plus en plus réglementée, finira peut-être par devenir une affaire de privilégiés, de braconniers, -un retour en somme au Moyen Age -, à moins que le radoucissement des moeurs n’en fasse un jour une coutume méprisée. Si le conseil municipal adoptait une politique d'entretien de cette forêt par les cochons, il y aurait place pour des milliers de bêtes. Il suffirait d'entourer le village avec ses jardins, ainsi que les routes qui le traversent, par un simple grillage à moutons, renforcé par une clôture électrique, consistant en un seul cable, bien tendu, entre des isolateurs en porcelaine. Compte tenu d’une probable opposition de la part des chasseurs et pour des raisons de gestion pratique, il sera sans doute plus sage de commencer par des parcs plus petits, ne couvrant qu'un seul versant, séparés entre eux par une bande "verte" destinée à abriter la vie sauvage, et de réduire par conséquent d'autant le nombre de bêtes. Il sera nécessaire d'embaucher plusieurs porchers ou, pourquoi pas, quelques jolies porchères. Les dépenses d'infrastructure se limiteront donc à l'achat de quelques kilomètres de grillage. J'ai moi-même installé environ sept kilomètres de cette clôture, utilisant mes propres piquets de châtaignier et là où c'était possible, des arbres vivants, - car une clôture ombragée nécessite moins d’entretien -, une petite tronçonneuse et plusieurs hivers de travail dans l'air pur de la montagne. III Une agriculture à grande échelle reste inévitable, car, pour l’instant, il faut nourrir les villes et le monde. Dans certains domaines elle doit sans doute être intensive et industrielle, sans que pour autant il soit nécessaire de sacrifier à la qualité. Avec mon petit troupeau je ne peux fournir en viande que quelques familles, des privilégiés qui savent me trouver, ou qui connaissent d'autres éleveurs travaillant comme moi. Ce que nous faisons mérite à peine le nom d’agriculture. C’est surtout une excellente manière de vivre. Nul besoin de perdre cette perspective en en élargissant l’échelle. Une commune comme la nôtre pourrait subvenir aux besoins d’une petite ville, sans pollution, sans infrastructures excessives et lourdes, alors que le prix de cette viande de qualité resterait sans doute très abordable. Une population de vieux et de chômeurs se verrait augmentée de quelques jeunes ou moins jeunes paysans, qui pourraient s’installer chacun sur une parcelle de cinquante hectares. Le bois deviendrait exploitable. Sur cinq mille hectares, ainsi aménagés en parcs, pourront vivre cinquante mille poules, cinq mille cochons et autant de moutons: simple extrapolation de notre propre situation. Une centaine de familles y trouverait un lieu de vie. Il y a des millions d'hectares de forêt négligée et de terres en friche. Pour chaque région, des calculs plus précis doivent être faits pour ce qui concerne la densité de la population, la nature de la forêt d’origine, les dimensions des parcs, etc. La vie sauvage trouvera son expression dans les réserves naturelles, qui fonctionneront peut-être en même temps comme réserves de chasse. La restauration de la forêt dans le monde est une priorité, même si son rôle dans l’absorption de gaz à effet de serre doit être reconsidéré. Il serait envisageable d’y faire contribuer le cochon. La naiveté d’une telle proposition ne doit pas étonner, la nature possède une logique à laquelle se soumettent sans trop de questions animaux, plantes et enfants. Nous autres, hommes, n’avons pas fini d’essayer de la comprendre. La maîtrise en est cependant à ce prix. Comme je l’ai dit, il est fort probable par ailleurs, qu’une agriculture intensive et à grande échelle restera, pour longtemps encore, indispensable, afin de continuer à nourrir les villes et le monde. Elle pourra rester cantonnée à quelques régions propices où je m’imagine qu’on pourrait la pratiquer, avec les énormes moyens mécaniques dont nous disposons, en avenues de la largeur d’une autoroute et d’une longueur comparable. Ces avenues seraient séparées les unes des autres par des bandes de même largeur ou plus larges, occupées par une forêt à l’état naturel, connectées entre elles par un tunnel ici et là. Une pareille stratégie agricole présenterait un double avantage: en premier lieu la forêt ignore de telles séparations qui, pour elle, ne sont qu’une clairière étirée en longueur, et elle se comportera par conséquent comme une surface boisée ininterrompue, gardant sa qualité d’écosystème riche en biodiversité, et, deuxièmement, les cultures ainsi mises en place, tireraient bénéfice de la protection de cette forêt proche, qui aplanira les déséquilibres résultant de leur artificialité par l’absorption de la plus grande partie des maladies et des nuisibles propagés par le vent ou autrement. En outre, les travaux de culture et de récolte d’une avenue d’une centaine de kilomètres de long s’avéreront plutôt plus aisés, moins consommateurs d’énergie et plus facilement robotisables. Une telle révolution ne se fera pas sans intervention autoritaire des états. En temps de guerre, une pareille intervention est considérée comme acceptable. La guerre pour notre survie doit bien valoir un tel sacrifice. © Augustin Thyssen, 1999 |